
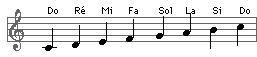
Films présentés par Sabine de Puteaux :
Belle de jour de Luis Buñuel
Buñuel crée, à partir du roman de Joseph Kessel, un personnage, Séverine, aux prises avec ses tourments, ses démons intérieurs. Incarnée par Catherine Deneuve, cette bourgeoise qui s’ennuie dans son couple, cette Madame Bovary version 1967, va se laisser tenter par la prostitution haut de gamme. La force de Buñuel est de mettre en scène tant les pensées du personnage que la réalité de son quotidien.
On pourrait dire que Séverine projette dans la réalité, comme sur un écran de cinéma, ses désirs, ses peurs profondes, ses souvenirs d’enfance et ses phantasmes. A tel point que le rêve, peu à peu, en vient à ne plus se distinguer du tout de ce qu’elle vit au jour le jour. Le spectateur est dérouté et déstabilisé car il peine à différencier le réel de l’imaginé. Le film et le personnage prennent en quelque sorte un aspect littéraire, le spectateur est comme un narrateur en situation de point de vue interne : on nous raconte les songes du personnage principal, on entend son monologue intérieur et on sait ce qu’elle pense, souhaite, désire, on est témoin du lien qu’elle fait avec d’autres événements de son enfance et on assiste même à ses rêves nocturnes. Finalement, les scènes les plus ancrées dans la vie réelle semblent flotter dans un nuage d’irréalité, comme suspendues, sans enjeux ni consistance alors que les scènes fantasmées paraissent crues et vraiment vécues. Au-delà du réel, c’est le surréel qui triomphe chez Buñuel. Ce film explore la tentation et les conséquences d’une transgression. Il transgresse la convention qui établit une frontière formelle entre le rêve et la réalité. Face au carcan froid et normé de la bourgeoisie et du mariage, il renverse avec plaisir certains tabous, sexuels et religieux notamment. A travers le personnage incarné par Michel Piccoli, les moments les plus tragiques sont souvent ceux où l’on a le plus envie de rire. Car Buñuel n’oublie jamais le comique qu’il peut tirer d’une situation. A la fin, face au visage lisse de Catherine Deneuve, aux traits imperturbables, on se demande presque si tout n’était qu’un rêve…
Shadows de John Cassavetes
Cassavetes réussit la gageure de réaliser un film sans intrigue qui ne tient que par la force de sa forme, de son style, comme le rêvait Flaubert pour ses romans. Pour cela, il superpose deux partitions, celle de la vie décousue des personnages et celle, tout aussi improvisée, de la musique de jazz, interprétée par les grands Charlie Mingus à la contrebasse et Shafi Hadi au saxophone. Les deux s’entremêlent dans une errance aléatoire, à l’image de la vie, surprenante et trépidante, entre harmonie et disharmonie. Ruptures de formes, cadrages insolites et suggestifs, rythme effréné et irrégulier des plans qui se succèdent, mettent en œuvre une entreprise de déconstruction jubilatoire. Ce film est un exercice de style de haut vol, qui fait voler en éclats toutes les conventions du cinéma. Improvisation virtuose et magistrale, l’œuvre prend son autonomie en renversant les codes et bouleversant les règles et les tabous. Ainsi, l’actrice Leila Goldoni, belle à faire chavirer les cœurs, se montre de plus en plus exigeante envers ses « prétendants », et ose embrasser brusquement un inconnu. L’enseignement et la culture officiels tout comme l’art contemporain sont moqués et leur légitimité interrogée. Le spectateur est obligé de rester attentif du début à la fin, happé, comme en apnée. Ainsi les jeunes arrivent au MOMA et tombent sur la sculpture de Balzac par Rodin. Suit une discussion sur l’art. Le film revendique une totale liberté. Il dresse le portrait d’une jeunesse newyorkaise des années 1959, à l’humour cassant, acéré comme une lame de rasoir, parfois blessant, aiguisé et strident. Une jeunesse éprise de liberté et de séduction, bohème, qui fume et boit au rythme de la batterie et qui drague les filles. Une jeunesse excitée, les nerfs à vif, prête à s’enflammer comme un feu de paille à la moindre étincelle. Les conversations virent souvent à la bagarre, les scènes de séduction font naître des jalousies, le culot dégénère en brutale dérouillée. Les thèmes abordés sont comme des motifs musicaux sur lesquels on improvise et sont sujets à des variations infinies. Les scènes de dragues simultanées montrent les différents couples qui improvisent, comme des musiciens, cherchant un terrain d’entente. L’énergie qui se dégage de l’œuvre semble débordante. Le rythme est haché, scandé, comme un air de free jazz, brisé par des ellipses qui fractionnent le film en épisodes, les dialogues rapides, les conversations dynamiques, les personnages courent dans la rue ou à travers les parcs. On les suit dans leurs tribulations sans but apparent, épousant une forme d’insouciance, au son du saxophone qui tente de les suivre. Ivre de sons et d’images, le spectateur est plongé dans une ambiance urbaine, il arpente les rues sombres, sillonnées par des voitures, il pénètre dans l’effervescence des cafés et des clubs de jazz. La manière de filmer de Cassavetes, très moderne, privilégie les plans très serrés sur les personnages, qu’on toucherait presque, conférant une sensation presque tactile au film. Et pourtant Cassavetes filme en adoptant une certaine objectivité, donnant presque l’impression d’un reportage sur cette jeunesse imbibée de pop culture. Il se poste au milieu des bruits réels de la rue, d’une gare ou d’un café, avec des personnages qui parlent les uns sur les autres dans un joyeux bazar, en décor naturel, choisissant parfois des cadres qui coupent délibérément les corps et les figures. On est à la fois familiers et extérieurs. Ce film opte pour une poétique du décousu et du fractionné qui swingue ! En revanche, lorsque les amants se retrouvent seuls dans un appartement, la musique se tait, discrète, le désir monte et la bouteille d’alcool prend une symbolique évocatoire, une puissance érotique et charnelle.
Vertigo d'Alfred Hitchcock
Ce film construit en deux parties se prête à mille et une interprétations. Il engage le spectateur dans une spirale du temps et de l’espace, symbolisée notamment par le chignon enroulé de Kim Novak et l’œil de James Stewart, images fixes mais évoquant une profondeur sans fond. San Francisco apparait comme un dédale de rues en pente qui donnent le tournis. Le spectateur est témoin du vertige du personnage qui perd pied malgré sa tentative de contrôle. Tout comme son personnage, Hitchcock manifeste une volonté extrême, voire excessive, de maitriser totalement chaque image de son film. James Stewart, intérieurement torturé, cherche à recréer dans la réalité l’image de la femme disparue qu’il aime. Son fantasme tourne à l’obsession, à la névrose, presque à la folie. La femme, objet de désir et de fascination, semble littéralement revenir « d’entre les morts », comme dans le roman de Boileau-Narcejac, Sueurs froides, qui a inspiré le film. Ce rêve réalisé lui permettrait de guérir de sa phobie du vide et de l’altitude. Le film est en permanence écartelé entre haut et bas, travelling avant et travelling arrière, horizontalité et verticalité, quête d’équilibre et vertige, stabilité et perte de repère. La verticalité est sans cesse menacée par le précipice. Le pont de San Francisco s’oppose à la chute du corps dans l’eau. Maitriser l’espace n’est-il pas le rêve de tout réalisateur ? Lorsque James Stewart observe Kim Novak chez le fleuriste, Hitchcock recrée dans son film l’expérience du spectateur de cinéma, assis dans le noir, voyeur observant des acteurs qui se donnent comme images, images désirées et fantasmées. La musique de Bernard Hermann, omniprésente, elle-même vertigineuse, colle parfaitement à l’image, en devient indissociable. L’image, jamais purement illustrative chez Hitchcock, se suffit à elle-même, indépendamment des dialogues et du scénario. Comme dans le cinéma muet, elle fait sens. L’univers dans lequel baigne le film évoque aussi les récits policiers à énigme, tels les whodunit britanniques, bien qu’une partie de la résolution de l’intrigue nous soit donnée avant la fin. La fin n’est pas ce qui importe le plus pour Hitchcock, qui met surtout l’accent sur la manipulation des acteurs et sur le caractère symbolique des objets, comme autant de pièces à convictions qui vont mener le personnage vers la vérité, mais aussi comme collection fétichiste et sexuelle qui révèle la maniaquerie du personnage. Hitchcock réalise presque un méta-film, qui peut se regarder telle une réflexion sur le vertige de l’amour comme vertige de la création pour le créateur, en prise avec ses peurs et ses tourments intimes. Mais tout excès de maîtrise ne peut empêcher, à la fin, l’œuvre de s’échapper…
